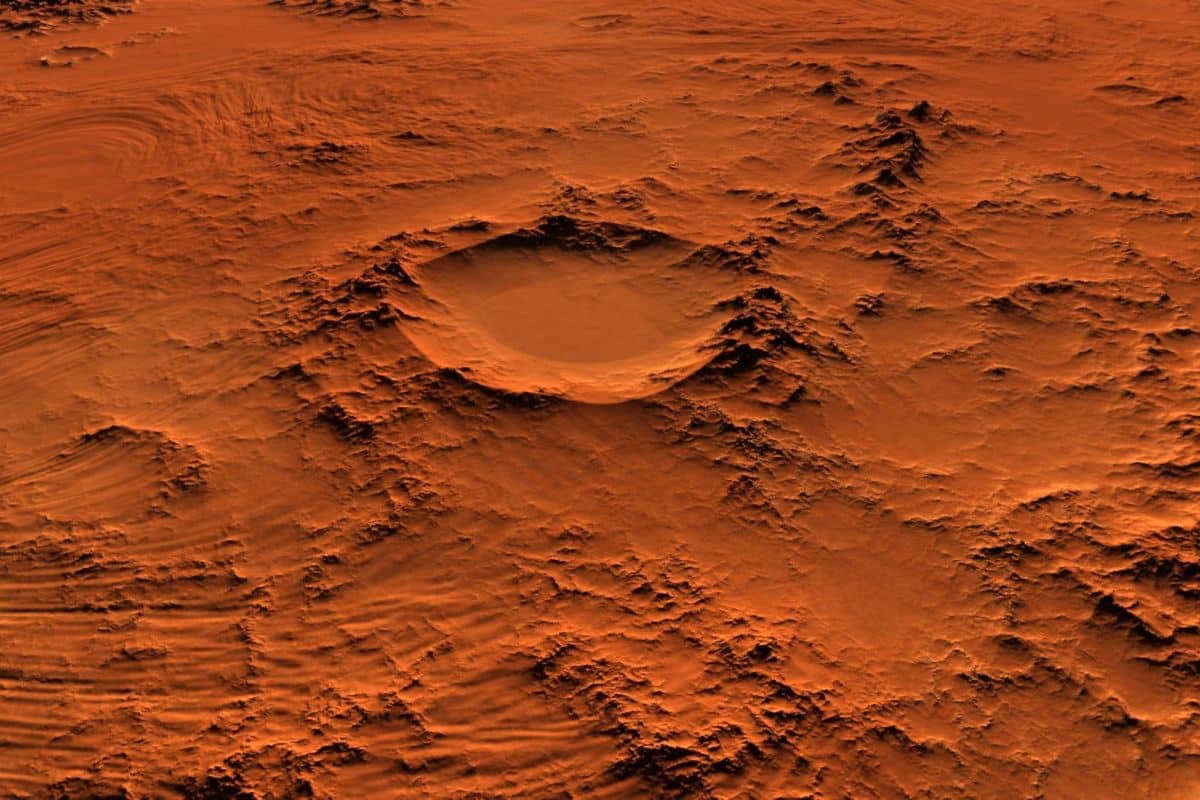Une étude révèle cette semaine la quantité considérable de minuscules particules de plastique contenant des additifs toxiques qui, invisibles, nous entourent dans les espaces clos et peuvent nuire à la santé. La présence généralisée de microplastiques dans l’air de différents environnements intérieurs est jusqu’à 100 fois supérieure à ce que l’on pensait jusqu’à présent, avec l’inhalation de jusqu’à 68 000 particules par jour pouvant avoir des répercussions sur la santé humaine. C’est ce que révèle une étude scientifique publiée cette semaine, qui remet au goût du jour une pollution de plus en plus préoccupante, mais qui continue pour l’instant d’augmenter, selon les scientifiques et les militants écologistes. Dans une semaine, de nouvelles négociations sur un traité mondial, parrainé par l’ONU, visant à limiter la production de ce matériau débuteront en Suisse, mais les perspectives ne sont pas bonnes.
Microplastiques : l’air de votre voiture est 30 fois plus pollué que l’extérieur

Certaines analyses récentes ont déjà montré que la concentration de microplastiques (ceux de moins de cinq millimètres) en suspension dans les espaces intérieurs est jusqu’à huit fois plus élevée qu’à l’extérieur. Elles ont également révélé qu’il y en a 30 fois plus sur les objets à l’intérieur d’une pièce. Étant donné que dans les pays développés, les gens passent 90 % de leur temps à l’intérieur, dont 5 % dans leur voiture, des scientifiques de l’université de Toulouse ont voulu vérifier à quelle quantité nous sommes exposés, en tenant compte des particules qui peuvent être inhalées car leur diamètre est compris entre 1 et 10 micromètres.
Pour le vérifier, Nadia Yakovenko et ses collègues ont analysé 16 échantillons d’air prélevés dans des habitations, des bureaux et des habitacles de véhicules à l’aide d’un spectroscope Raman, qui permet d’en vérifier les composants. Ils ont découvert que la concentration moyenne de ces particules dans les espaces résidentiels était de 528 unités par mètre cube et qu’elle atteignait 2 238 dans les véhicules, principalement du polyéthylène dans les premiers (très utilisé dans les textiles et les emballages) et du polyamide dans les seconds. En fait, ces particules représentent jusqu’à 97 % de la poussière totale analysée et 94 % d’entre elles ont une taille qui peut être inhalée. Ils ont ensuite combiné ces données avec celles déjà connues sur les densités. Ils sont arrivés à la conclusion que la situation, lorsqu’on recherche des particules plus petites, est bien pire que celle qui avait été détectée : les adultes inhalent chaque jour environ 3 200 particules d’un diamètre compris entre 10 et 300 micromètres, et jusqu’à 68 000 des plus petites.
Bien qu’ils soulignent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étendre ces résultats, ces conclusions, publiées dans la revue scientifique PLos One, suggèrent pour l’instant que le risque pour la santé humaine ne cesse d’augmenter en relation avec ce matériau. En effet, cela fait déjà deux ans qu’une étude les avait détectées dans les tissus pulmonaires humains, mais c’est maintenant la quantité inhalée qui est mise en évidence. « Où que nous regardions, nous les trouvons, et c’est préoccupant car elles sont totalement invisibles à l’œil nu et atteignent les parties les plus profondes de nos poumons », souligne Yakovenko dans un communiqué.
Ces composants peuvent libérer des additifs toxiques tels que l’isphénol A, les phtalates et les composés bromés

Jeroen Sonke, directeur de recherche au CNRS français, qui a collaboré à ces travaux, ajoute à La Vanguardia qu’en outre, « ils peuvent libérer des additifs toxiques tels que le bisphénol A, les phtalates et les composés bromés (retardateurs de flamme), qui sont des additifs qui perturbent le système endocrinien et augmentent le risque de naissances prématurées, de troubles du développement neurologique, de malformations congénitales masculines, d’infertilité, d’obésité, de maladies cardiovasculaires, de maladies rénales et de cancers ». Il reconnaît que l’on ne sait pas suffisamment combien s’accumulent dans les poumons ou sont expulsés par la toux ou les mucosités, mais il souligne que « certains resteront probablement là pendant des années et que les plus petits pénétreront dans les cellules pulmonaires ».
Dans le cas des habitations ou des espaces intérieurs, Sonke souligne que, outre les vêtements, les tapis, les moquettes, les rideaux, les sols en linoléum ou la peinture acrylique sont également à l’origine de ces polluants. « Nous vivons souvent dans une boîte en plastique tridimensionnelle et, avec le temps, les rayons UV et l’abrasion physique, tous ces plastiques se fragmentent ». Dans les véhicules, en outre, on utilise de plus en plus de plastique pour réduire leur poids dans un souci de durabilité.
Nous vivons souvent dans une boîte en plastique tridimensionnelle et, avec le temps, le rayonnement et l’abrasion physique, tous ces plastiques se fragmentent

La détection de microplastiques dans le corps humain est de plus en plus fréquente ces derniers temps. Ils ont déjà été trouvés dans le sang, le cerveau, le placenta, le système digestif et le lait maternel. Jusqu’à présent, la voie d’entrée la plus connue était l’ingestion (d’où la recommandation de ne pas réchauffer les aliments dans des récipients), mais on sait désormais qu’ils sont présents partout : dans les nuages, dans les laitues cultivées ou dans toute la colonne d’eau de l’océan, comme l’ont également publié il y a quelques semaines.
Des scientifiques tels que la chimiste Ethel Eljarrat, directrice de l’Institut de diagnostic environnemental et d’études de l’eau (IDAEA-CSIC), ou Nicolás Olea, de l’université de Grenade, alertent depuis des années sur le risque présenté par les composants adhérant aux polymères, qui leur confèrent des caractéristiques différentes selon leur destination finale. Eljarrat commente que ces résultats français concordent avec des études antérieures de l’IDAEA et souligne que « plus les microplastiques recherchés sont petits, plus ils apparaissent en grande quantité, mais il faut encore approfondir les recherches sur les impacts sur la santé en raison des nombreux toxiques associés, chacun ayant un effet ».
Dans le même ordre d’idées, le chercheur Nicolás Olea insiste sur le cocktail de composés chimiques auquel nous sommes exposés : « On parle beaucoup de l’impact physique, du fait qu’ils provoquent une inflammation et une oxydation cellulaire, mais il y a aussi les effets biologiques et organiques causés par les composés qui les accompagnent et que les bébés et les animaux domestiques respirent en permanence dans les sols de nos maisons ».
Interrogés sur les recommandations à donner aux citoyens, les trois scientifiques s’accordent sur l’importance d’aérer quotidiennement, d’aspirer la poussière, d’éviter les matières synthétiques dans la décoration ou les vêtements et, de manière générale, d’acheter peu de plastique. Sonke conseille également de « voter pour des partis politiques qui prennent au sérieux l’écologie et le changement climatique ». Aux industries, il recommande de « concevoir des produits moins toxiques ». Ces conseils sont similaires à ceux figurant dans un guide de l’Association des patients atteints de BPCO destiné aux personnes souffrant de problèmes respiratoires.
Au niveau international, face à l’urgence de mettre un terme à la pollution plastique, les négociations se poursuivent autour d’un traité mondial, promu par l’ONU, visant à limiter la production, à promouvoir et à soutenir un recyclage plus efficace et à améliorer les conceptions. La prochaine réunion, qui se tiendra du 5 au 15 août à Genève (Suisse), la sixième, arrive sans qu’il y ait eu jusqu’à présent de progrès significatifs entre le bloc des pays pétroliers et producteurs, qui refusent de réduire leur production, et ceux qui sont les plus enclins à fixer un plafond, comme cela a été le cas jusqu’à présent dans l’UE. Mais sur cette question, comme sur d’autres questions environnementales, la Commission européenne a déjà indiqué qu’elle était prête à « assouplir » sa position afin de parvenir à un consensus qui, selon les organisations environnementales, pourrait le rendre très édulcoré.